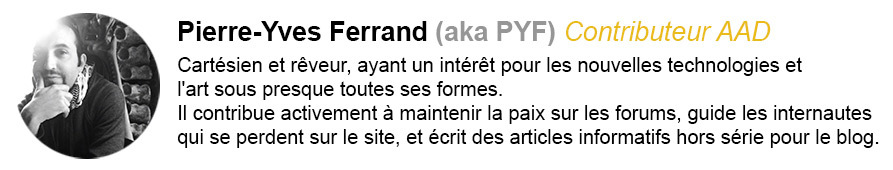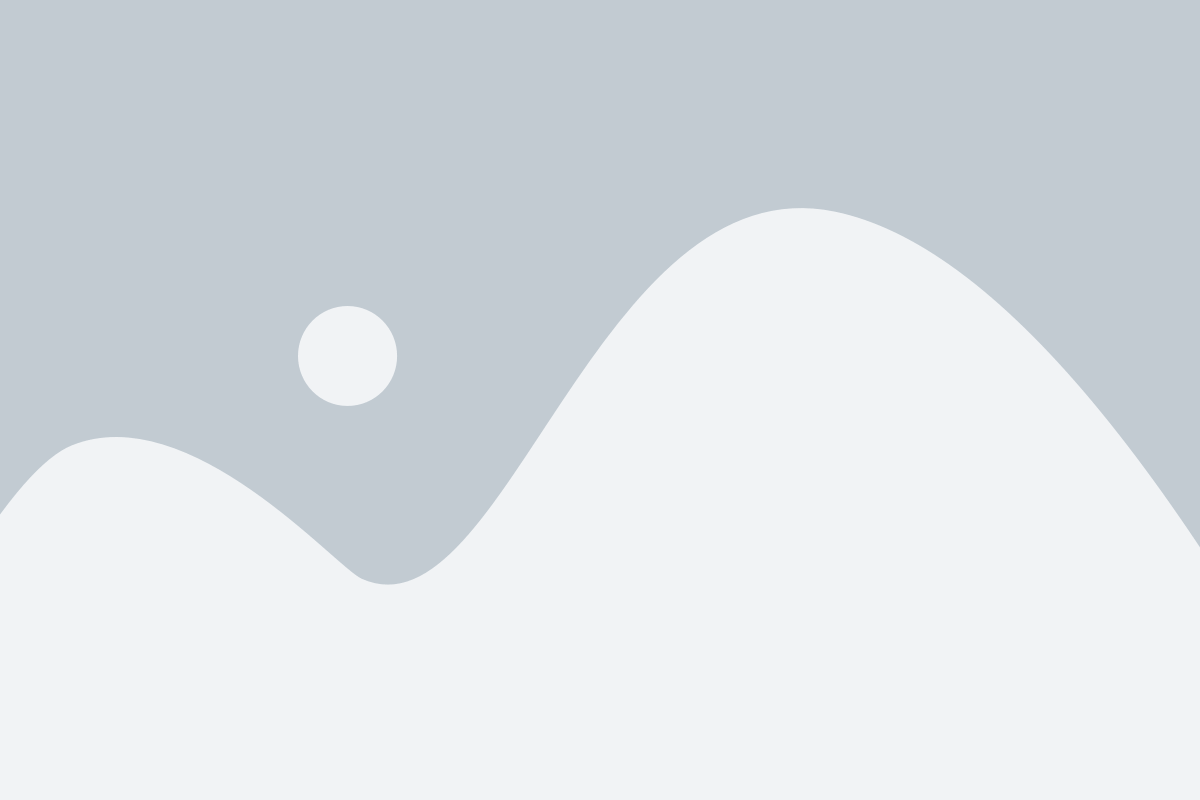Turbulent ou simplement sûr de ses choix ?
Gustave Courbet est né dans le département du Doubs, plus précisément dans la commune d’Ornans, le 10 juin 1819. Sa famille était aisée, possédant des terrains, et une ferme. Gustave était l’aîné des enfants et avait toujours été profondément aimant avec ses sœurs Zélie, Zoé et Juliette.
Son premier contact connu avec l’art se produisit lorsqu’il rentra au petit séminaire d’Ornans à 12 ans. Si aujourd’hui cette institution est désuète, il faut savoir que jusqu’au milieu du 20e siècle, cela représentait, pour les enfants doués vivant à la campagne, l’une des seules opportunités de suivre une instruction. On y formait alors aussi bien les futurs séminaristes (intégrant le grand séminaire) que des enfants qui resteraient laïcs. La petite bourgeoisie catholique avait ainsi la certitude que ses enfants recevraient une éducation classique de qualité tout en étant soumis à une discipline stricte.
Courbet se montra turbulent et paresseux. Les langues et les mathématiques ne lui plaisaient pas, mais il se passionna aussitôt pour le dessin dont il apprit les rudiments par le biais d’un professeur, le « père Beau ». L’élève en sut bientôt plus long que le maître, ce dernier étant plus consciencieux que talentueux.
Courbet réalisa ses premières œuvres: la Source de la Loue et quelques portraits de camarades.
Régis Courbet, son père, n’aimant pas l’idée que son fils puisse devenir autre chose qu’un polytechnicien, envoya Gustave en 1837, au Collège Royal de Besançon en internat. Le futur grand peintre ne se fit pas à la vie du Collège: la météo ne lui convenait pas, tout comme le rythme scolaire ou l’alimentation proposée aux étudiants. Par chance, il suivit les cours de dessin de Charles-Antoine Flajoulot. Ce dernier était un ancien disciple de Jacques-Louis David (chef de file du mouvement néo-classique) et dirigeait les Beaux-Arts de Besançon. Courbet devint le meilleur élève de ces cours de dessin qui constituaient une échappatoire pour l’enfant. Il supplia sa famille de le laisser devenir externe et après bien des échanges avec son père, plus une menace de fugue, celui-ci finit par céder et lui trouva une chambre.
Heureux et reconnaissant, Courbet se donna au maximum pour satisfaire son père. Mais il avait trop la tête à la création artistique et voulait se perfectionner.
Courbet ne réalisa donc pas les études qu’on attendait de lui et en 1839, il quitta le Collège Royal, direction Paris. Afin de convaincre son père, il commença des études de droit, mais sans rien lui révéler de ses ambitions artistiques.
Courbet avait un peu plus de vingt ans quand il arriva à la capitale. Son attirance pour l’art était toujours présente, car dans le même temps, il se forma dans l’atelier du peintre Charles de Steuben, spécialiste des sujets historiques. Un ami peintre, Adolphe Marlet lui conseilla de fréquenter aussi l’atelier du peintre d’histoire et de mythologie, Nicolas-Auguste Hesse. Ce dernier prit rapidement conscience du potentiel de Gustave Courbet et le poussa à élargir ses connaissances artistiques. Fort de ce soutien, le jeune Courbet passa alors de longues heures dans les musées afin d’étudier les œuvres de maîtres.
En 1840, il disposa de davantage de temps pour son art, après avoir abandonné ses études de droit et ayant été réformé de l’armée. Il effectua ses premières copies au Louvre. Sa vie fut alors bien modeste et précaire, mais il n’était pas plus attiré que cela par les tentations que pouvait offrir la vie parisienne. Une subvention paternelle maigre, des relations père-fils pas vraiment au beau fixe, mais Gustave était résolu à supporter bravement toutes ces difficultés. D’ailleurs pour se faire un peu d’argent, il réalisa les portraits des bourgeois qui le démarchaient.
Durant cette période parisienne, l’artiste n’avait pas encore trouvé sa voie. Ses œuvres oscillaient entre classicisme et réalisme, entre paysages et sujets de genre. Néanmoins, on sent que c’est par le biais des portraits que Courbet se réalise le plus. Les portraits de ses sœurs en sont un exemple.

Courbet et le Salon
Conscient de ses facultés pour le portrait, il fit en sorte d’en incorporer le plus possible dans les œuvres qu’il peignait. Est-ce pour des questions pratiques ou par mégalomanie, mais c’est pendant cette période qu’il commença à se peindre dans la plupart de ses réalisations. Rares furent les œuvres où l’on ne retrouvait pas sa propre image. En 1841, il réalisa les portraits de deux de ses amis, mais les deux toiles furent refusées au Salon.
Son image, Courbet savait l’utiliser d’autant plus qu’elle laissait transparaître une pointe de romantisme, ce qui était vraiment à la mode à cette époque. Cela lui permit de franchir les portes du Salon pour la première fois avec son « Autoportrait au chien noir », œuvre peinte en 1842 et exposée alors en 1844.

Cette première admission au Salon remplit de joie le jeune artiste et surtout lui permit de démontrer son talent à son père qui ne croyait pas en la carrière artistique de son fils. La critique fut unanime pour cette première participation.
L’année suivante, Courbet tenta de nouveau sa chance au Salon. Il présenta 5 œuvres, mais une seule fut retenue, « le Guitarrero ». Cette nouvelle participation au Salon fit grandement plaisir à Courbet, mais il regretta que l’œuvre retenue fut la moins bonne à ses yeux.

L’artiste avait des goûts simples et n’était pas obsédé par l’argent; c’est la gloire qui l’intéressait alors. «Il faut qu’avant 5 ans, j’aie un nom dans Paris». Déjà gros travailleur, il augmenta son rythme. Pour se ressourcer et ne pas se brûler les ailes, il fit un séjour dans sa ville natale.
À son retour sur Paris, l’artiste était alors gonflé à bloc et prépara le Salon de 1846. Sur les 8 œuvres qu’il avait préparées, une seule encore fut retenue. Il laissa alors éclater sa colère. Lors de l’édition précédente, il n’avait en réalité que peu apprécié le fait de voir une seule de ses œuvres retenues et voilà que cela recommençait. Cela eut pour conséquence son absence dans l’édition de 1847, toutes ses œuvres ayant été refusées. Son attitude provoquait l’hostilité du jury, quitte à se passer de potentiels chefs-d’œuvre. Courbet partageait avec Delacroix et d’autres une certaine disgrâce et vit les portes du Salon se fermer.
Indépendants, incompris et rejetés tentèrent une coalition afin d’organiser une Exposition rivale. Mais la Révolution française de 1848 les empêcha de donner suite; une Révolution à laquelle Courbet ne prit aucune part, la politique ne l’intéressant qu’assez peu malgré ses opinions avancées. Il était trop absorbé par son art. Il réalisa 6 tableaux qu’il présenta au Salon. Ce dernier finit par tous les accepter et l’un d’eux eut un grand succès : « Le Violoncelliste ».

Un grand succès certes, mais pour la fortune, il allait falloir encore attendre. Même si l’argent n’était pas le but premier de l’artiste, ce dernier commençait à avoir des dettes et à ne plus pouvoir s’habiller décemment. Ses démêlés avec le Salon avaient probablement retardé sa fortune, mais avaient aussi servi sa réputation. Ainsi, un clan autour de lui se forma, composé de nombreux amis très fidèles.
D’ailleurs, quand Courbet ne travaillait pas, il les retrouvait à la brasserie Andler (qui était, dans les années 1840-1860, un lieu animé de rendez-vous et de rencontre pour les étudiants, les artistes et les personnalités de la gauche républicaine).
Courbet et la critique
Au salon de 1849, Courbet présenta 7 toiles qui furent une nouvelle fois toutes admises. Deux œuvres eurent un grand succès: un portrait « l’Homme à la ceinture de cuir » (œuvre qui fut achetée par l’État après la mort du peintre) et une scène de genre « l’Après-dînée à Ornans ».


Concernant cette scène de genre, les avis furent partagés. Delacroix cria au génie et félicita chaleureusement Courbet. Ingres fut bien plus mitigé. S’il reconnaissait les talents rares de Courbet, il trouva dommage d’utiliser de tels dons pour produire une « œuvre aussi vulgaire ». Enfin, les proches de Courbet durent arracher au critique d’art Théophile Gautier quelques louanges.
Bref, la critique faillit se déchaîner contre le style de Courbet. Mais ce dernier allait bientôt fournir à ses détracteurs de quoi se défouler sur lui.
En effet, lors d’un voyage à Ornans, il occupa ses journées à peindre différentes toiles dans lesquelles son style réaliste s’affirmait de plus belle. L’une d’elles étant « Les casseurs de pierres »; on y retrouve un vieil homme usé menant une tâche laborieuse, assisté d’un enfant tout autant à la peine. Une autre toile s’intitule un « Enterrement à Ornans ». Encore une fois, il n’embellit pas la réalité et représenta les personnes telles qu’elles étaient lors de cet enterrement. Enfin, avec la troisième toile, « Les Paysans de Flagey revenant de la foire », Courbet voulait rendre hommage à sa région et au dynamisme des paysans.
Ainsi, avec ces 3 œuvres, les critiques eurent du grain à moudre vis-à-vis de Courbet.
L’œuvre « Les casseurs de pierres » dérangeait, car elle montrait une scène réelle du travail des gens pauvres et renvoyait donc à une vérité bien cruelle. Pourtant, l’œuvre allait obtenir un vif succès. Pour l’« Enterrement à Ornans », ce fut un déchaînement général et ses détracteurs furent plus nombreux que ses défenseurs. Théophile Gautier demanda alors s’il fallait rire ou pleurer devant cette œuvre qu’il trouvait misérable. Certains y virent une « ignoble caricature » ou encore le « triomphe de la vulgarité et de la bassesse ».
Enfin, « Les Paysans de Flagey revenant de la foire » fit scandale également, mais dans une moindre mesure. L’œuvre mit le public mal à l’aise, car elle montrait, sans chercher à l’embellir, une réalité fort banale, voire triviale, et hissait une scène de genre au rang de peinture d’histoire.



Après toute cette folie autour de son style, Courbet retourna un temps s’isoler dans son village. Mais tout le monde était déjà au courant ce qu’il s’était passé au Salon et on ne lui réserva pas le même accueil qu’à l’accoutumée. Rapidement, les choses revirent à la normale, Courbet étant trop aimé à Ornans.
Il décida alors de prendre à contre-pied la critique. Il réalisa « Les Demoiselles de village », œuvre dans laquelle il fit figurer ses sœurs. La peinture fut envoyée au salon de 1852 et vendue avant même d’être exposée. Pour autant, cela ne calma pas la critique qui fut toujours aussi violente. Et parmi ses détracteurs les plus virulents, on compte un ancien soutien, Delacroix. Ainsi, même le « Gracieux » ne réussissait pas à Courbet.

Courbet décida alors de ne plus apporter de crédit aux critiques et de peindre selon ses goûts. Alors au salon suivant en 1853, il proposa 3 autres œuvres dont « les Baigneuses ». Ce tableau fut unanimement attaqué par la critique qui trouva la scène négligée et le caractère massif du nu en opposition avec les canons officiels (proportions idéales pour représenter un être humain). Les deux autres œuvres présentées furent « Les Lutteurs » qui reçut de vives critiques également et « la Fileuse » qui trouva un peu plus grâce devant la critique.

Des critiques, il en reçut aussi de ses amis. Le philosophe Proudhon et le poète Baudelaire, qui avaient pris la pose, estimèrent que leur ami peintre les avait enlaidis. Les critiques de ses modèles le rendaient fou de rage, car elles venaient à l’encontre de son obsession de la vérité dans ses œuvres. Embellir la réalité n’était pas envisageable même pour des amis.
Mécènes et soutiens
En 1853-54, Courbet rencontra à Paris, Alfred Bruyas, banquier et amateur d’art de Montpellier. Alfred Bruyas devint le mécène et l’ami du peintre qui lui rendit visite à Montpellier. Il peignit « La rencontre » et ses premiers paysages de Méditerranée. Globalement, Courbet comptait de nombreux soutiens dans l’Hérault.
C’est justement avec l’aide de Bruyas que Courbet décida d’organiser une exposition personnelle dans un pavillon qu’il fit construire à quelques pas du salon officiel et qu’il intitula « le Pavillon du Réalisme ». Il y présenta son tableau « L’Atelier du peintre » qu’il définit comme une « Allégorie réelle déterminant une phase de sept années de ma vie artistique ». Le résultat financier de cette opération ne fut pas très brillant, mais elle eut pour effet de secouer l’opinion et d’ouvrir une vive polémique (pour ou contre le réalisme) dont bénéficia la notoriété du peintre.

Parmi ses autres soutiens, on peut citer :
- L’écrivain Champfleury avec qui Courbet finira par se brouiller gravement; ils s’accusèrent l’un l’autre d’avoir été corrompus par l’État,
- Jules Castagnary, critique d’art qui le défendit jusqu’à sa mort,
- François Sabatier, lui aussi critique et mécène du peintre.
Malgré cela, d’autres de ses œuvres firent scandale lors de différents salons: en 1857 avec « Les Demoiselles des bords de Seine » en 1862 avec « Le retour de la Conférence »
Guerre et Déclin
En 1870, la France entra en guerre contre l’Allemagne.
Dans le même temps, l’État, souhaitant gagner le cœur de ses adversaires en France nomma Courbet chevalier de la Légion d’honneur. Titre que le peintre refusa.
Il suivit le déroulement de la guerre et l’avancée de l’armée allemande. Une fois l’Empire renversé, la République fut proclamée. Courbet fut alors nommé président de la Commission des arts, chargée de la sauvegarde des œuvres d’art parisiennes. À peine en poste, il demanda le déboulonnement de la colonne Vendôme «car elle est dénuée de valeur artistique et tend à perpétuer les idées de guerre et de conquête.» Le Gouvernement ne donna pas réellement suite à cette demande, préférant faire fondre la statue de Napoléon pour dresser sur la place de la Concorde, un monument à la gloire de Strasbourg, la vaillante cité martyre et qui allait passer en territoire Allemand.
Thiers fut nommé président de la République avec pour but de négocier la Paix. Entre les conditions de cette paix et la crainte d’un retour à la monarchie, la révolution régna dans Paris. C’était la période insurrectionnelle de l’histoire de Paris que l’on nomme la Commune.
Courbet reprit alors son projet d’abattre ou tout du moins de déplacer la colonne Vendôme et sa demande fut cette fois-ci entendue. Le peintre fut élu délégué aux Beaux-Arts par la Commune. Il espérait pouvoir jouer un rôle de médiateur, de pacificateur.
Le 7 juin 1871, après la «semaine sanglante» et l’écrasement de la Commune, Courbet fut arrêté puis jugé. Le 2 septembre, il fut condamné à six mois de prison et 500 francs d’amende. Sa mère allait en mourir de chagrin.
Une fois en prison, Courbet pensa immédiatement à peindre. On ne lui confisqua pas son matériel tout comme on ne lui interdit pas de recevoir de la visite. Ses sœurs, toujours aussi aimantes, lui furent d’un grand secours. Comme il n’avait pas de modèle et qu’il recevait des fleurs pour égayer sa cellule, il se mit alors naturellement à peindre celles-ci. Et avec une grande rapidité, car en quelques heures, une nouvelle composition était réalisée.
Cela dit, l’environnement de la cellule n’était pas sain et cela eut des répercussions sur la santé du peintre. Il fut alors transféré dans un établissement de bien meilleure qualité où il termina sa peine.
Une fois libéré, Courbet compta sur l’oubli afin de reprendre sa vie d’avant. Malheureusement, alors qu’il était au sommet de son art, la méchanceté l’attaquait déjà. Et même s’il était un être déchu, elle ne désarma pas. Courbet s’en rendit compte lors du Salon de 1872. Le président du Jury, Meissonier, déclara aux jurés : « Inutile de regarder ses œuvres, la question d’art n’a rien à voir ici, mais seulement une question de dignité. Courbet doit être mort pour nous »
Et il ne s’agissait là que d’un début.
Courbet fut condamné à rembourser à l’État la somme de 323 000 francs suite à la destruction de la Colonne Vendôme. Les saisies se multiplièrent et comble de malheur, il se fit dérober des œuvres qu’il avait cachées aux huissiers; valeur du vol: 150 000 francs.
Sentant que les échéances deviendraient impossibles à honorer, il quitta la France pour la Suisse. Il y mena une vie modeste tout en continuant de peindre, notamment en extérieur dès que le temps le lui permettait.
À plusieurs reprises, il s’aventura discrètement en France, mais sa présence était rapidement signalée et il devait retourner en Suisse.
Les différentes tribulations du peintre laissèrent des traces sur sa santé qui déclinait très rapidement. Il ne se faisait plus d’illusions, mais trouva encore la force de réconforter les siens sur son lit de mort.
Malade du foie, Courbet expira le 31 décembre 1877 au petit matin. Il fut inhumé à La Tour-de-Peilz (Suisse), là où il passa ses dernières années d’exil. Lors de la cérémonie, des personnalités venues de toute l’Europe lui rendirent un dernier hommage.
Sa dépouille fut transférée dans son village natal d’ Ornans en 1919.
Anecdotes sur Gustave Courbet
- À partir de 1837, Courbet fréquenta donc le Collège Royal de Besançon et eut comme enseignant Charles-Antoine Flajoulot. Ce fut aussi le cas de Louis Pasteur, le grand scientifique français. Pasteur entra dans ce collège en 1839, mais ils ne se croisèrent jamais. Des événements avancèrent le départ de Courbet tandis que d’autres retardèrent l’arrivée de Pasteur. Ce dernier avait pris la direction de Paris pour ses études, mais la peine causée par l’éloignement familial le fit rapidement revenir. Les inscriptions étant alors closes au Collège Royal de Besançon, Pasteur termina son année au Collège d’Arbois sans que cela ne lui donnât de meilleures bases en mathématiques et sciences. Ce n’est qu’à la rentrée 1839 qu’il intégra le Collège Royal de Besançon alors que Courbet était déjà parti à Paris.
- Courbet était donc le meilleur élève de Charles-Antoine Flajoulot. Ce dernier avait rebaptisé le jeune homme : « Le Dieu de la couleur ».
- Lorsque Courbet réussit à convaincre son père de faire de lui un externe, il logea alors dans une maison qui vit naître Victor Hugo.
- Certains reprochèrent à Courbet d’être vaniteux étant donné qu’il se représenta dans beaucoup de ses œuvres. Il faut néanmoins préciser que Courbet était alors pauvre et donc payer un modèle lui était impossible.
- Cela dit, tous les tableaux dans lesquels Courbet se représenta ne datent pas de la même période. Une fois célèbre, il continua de se représenter. On peut donc en conclure qu’il avait une assez bonne image de lui-même.
- Pour le défendre, on peut dire que l’artiste disposait de caractéristiques physiques intéressantes pour l’art: Une chevelure souple, un front bien dessiné, des yeux expressifs, des joues pleines, sans oublier sa bouche expressive et moqueuse ou encore son menton bien taillé. D’ailleurs, au cours de son existence, il modifia régulièrement son apparence (coupe de cheveux, type de barbe) et consigna le tout sur toile.
- L’œuvre « Les Demoiselles de village » fut achetée par le comte de Morny qui était le bras droit de Napoléon. Un peintre de courant socialiste protégé par un bonapartiste, il y avait de quoi être surpris.
- Face aux « Baigneuses », Napoléon III, scandalisé par l’œuvre, aurait cravaché cette dernière sans la détériorer pour autant.
- Un jour, pour animer sa solitude en prison et faire une plaisanterie à ses geôliers, il peignit sur le mur, à côté de son lit, une tête de femme qui semblait émerger des draps. Le trompe-l’œil était si parfait que le directeur de la prison, en entrant dans la cellule, pensa immédiatement à une grave infraction aux règlements de la prison. Puis, en s’approchant, il se rendit compte de l’erreur et quitta la cellule amusé par la farce du peintre prisonnier.
Pour notre prochaine fiche, nous évoquerons la vie tumultueuse de Paul Gauguin.
Télécharger la fiche (Format PDF)